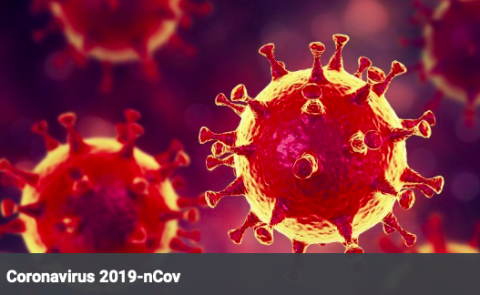Un Etat contre le droit
Lorsqu’on évoque la force du droit en République centrafricaine, il est important de se
remémorer dans quel contexte s’est faite l’affirmation du droit. Rien n’illustre mieux la fragilité juridique qui perdure dans ce pays que la longue et infructueuse lutte de son père fondateur, Barthélémy Boganda (1910-1959), pour obtenir que les lois votées à Paris soient mises en œuvre par l’administration coloniale à Bangui en dépit des réticences des élites locales. Boganda n’était pas un révolutionnaire à proprement parler car il était député de la République française, mais cette revendication lui a valu la haine tenace du colonat français. Sa mort – dans un accident d’avion – reste l’objet de multiples supputations (au moins pour les élites centrafricaines) et sa succession n’a pas suivi la règle constitutionnelle60.
Les décennies qui ont suivi l’indépendance ont été riches en combats de prétoire et en
convocations de cours constitutionnelles, certains avocats y ont gagné leur prestige politique61 et aussi des années d’exil ou de pressions physiques. La défense de la légalité républicaine n’a jamais été une caractéristique des régimes centrafricains, comme le rappellent de manière récurrente les rapports des organisations des droits de l’homme sur ce pays. Arrestations arbitraires, spoliations, violences et rackets des populations par des représentants de l’autorité publique, la liste est longue, même si ce non-droit n’a jamais été absolu ni permanent jusque dans la période la plus récente.
Que l’influence française ait été déterminante ou moins pesante, le fonctionnement du
système judiciaire a donc toujours été au mieux médiocre, au pire calamiteux. La France, sauf à réécrire l’histoire des régimes qu’elle a soutenus à bout de bras, ne pourra jamais prétendre avoir été de façon constante du bon côté, y compris dans la dernière décennie. L’intervention Sangaris et la période qu’elle a ouverte pour la Centrafrique reproduisent les mêmes incohérences pour des gains politiques microscopiques et peu durables. Mais pointer les responsabilités françaises ne doit faire oublier ni l’indifférence d’élites gouvernantes centrafricaines, ni le silence des autres partenaires internationaux et notamment de l’Union européenne et des Etats-Unis, fondamentalement suivistes par rapport à Paris.
Il existe de multiples traces de cette radicale faiblesse, bien au-delà de la sphère politique, dont témoignent par exemple les analyses de la Banque mondiale62 qui fournissent des indications sur le climat des affaires et la gestion de possibles contentieux, ou les rapports annuels, dénués de toute diplomatie inutile, du Département d’Etat américain sur les droits de l’homme dans ce pays63.
Dans la période qui nous occupe ici, les dévoiements se sont manifestés à plusieurs niveaux : celui de la justice ordinaire dont les activités pourtant ont bénéficié d’un appui financier européen conséquent ; celui de la Cour constitutionnelle qui s’est saisie à ses risques et périls de contentieux électoraux et finalement du débat sur le changement constitutionnel ; et enfin, celui de la Cour pénale spéciale (CPS), une structure hybride composée de magistrats centrafricains et étrangers censée pallier les déficiences des uns et des autres et lutter contre l’impunité64, en sus de la CPI.
Comme à leur habitude, la communauté internationale et les gouvernants à Bangui n’ont eu de cesse depuis janvier 2014 d’en appeler à la justice et au déferrement des criminels devant les tribunaux, et de célébrer la fin de l’impunité. Il eût été plus utile de réfléchir de façon réaliste aux besoins du pays et à une division du travail plus rigoureuse entre CPS et CPI, ces deux structures étant très coûteuses et avides de publicité65. Puis, les beaux discours achevés, le champagne bu et les lumières éteintes, la réalité quotidienne a repris ses droits, sans surprise.
Ces beaux discours sur la réforme du secteur de la sécurité, la réfection de palais de justice et les multiples séminaires pour l’appropriation de nouvelles lois ne disent rien en effet de l’effondrement du système judiciaire, du retour de la prédation par ses agents et de la requalification de l’arbitraire en loi souveraine. Dans une situation telle que celle de la RCA après 2013, le fonctionnement de l’appareil judiciaire était en effet crucial pour juger les délits communs qu’autorisait la situation de conflits et empêcher la pérennisation d’injustices évidentes (comme la confiscation de propriétés), mais aussi régler les mille et un conflits habituels de toute collectivité humaine, d’autant que le climat de violence sociale avait envahi les relations privées. Au risque de choquer, l’urgence était moins de juger « les plus criminels » que de prouver pratiquement à une population incrédule
que le fonctionnement de la justice ne serait jamais plus le même pour les petits et grands délits, pour les gens du commun et les « grandes personnes » (les élites, en français centrafricain). Ce pays grand comme la France et la Belgique ne comptait que trois tribunaux d’instance à Bouar, Bambari et Bangui : l’urgence était de construire ou de renforcer un système judiciaire et de donner un cadre à la justice coutumière. Mais la communauté internationale voulait dépenser son argent en se drapant dans de bons sentiments, et le gouvernement centrafricain a géré le budget de la justice comme une variable d’ajustement dans ses dépenses66.
La déception a été grande malgré quelques progrès obtenus grâce à la volonté de certains
acteurs centrafricains de mieux faire, et celle d’internationaux plus attentifs que leurs collègues ne l’avaient été par le passé. Reste une tendance lourde qui a pris toute son ampleur une fois le régime de Touadéra bien installé. Non pas que ce dernier ait eu le désir de perturber l’ensemble du fonctionnement judiciaire, mais il envoya les signaux d’un retour aux anciennes pratiques puis, la présence russe aidant, de la construction d’un autoritarisme où la politisation du système judiciaire devenait nécessaire pour réprimer les opposants réels ou imaginaires, et protéger les intérêts grands et petits des affidés.
Comme l’a écrit Amnesty International, « pratiquement toutes les procédures engagées devant les tribunaux ordinaires semblent porter sur des délits mineurs ou des crimes contre l’Etat plutôt que sur les crimes graves dont les personnes ont été victimes dans le contexte du conflit67 ». Le ministère de la Justice, selon le code de procédure pénale, doit organiser au minimum six sessions criminelles par an dans les préfectures de Bouar, Bambari et Bangui. Mais entre le 7 février 2020 et la fin 2021, aucune session n’a eu lieu en dépit de multiples déclarations du président Touadéra qui avait notamment affirmé que son second mandat donnerait la priorité à la lutte contre l’impunité. Il serait trop simple d’invoquer la pandémie ou la maladie d’un ministre de la Justice, Flavien Mbata, absent de son bureau et non remplacé pendant de longs mois. Comme toujours, l’ordonnancement du budget offre une meilleure explication : l’aide budgétaire spécifique de l’Union européenne, bien suffisante pour organiser ces sessions en province, s’est révélée fongible dans le budget national et les autorités ont décidé de changer les priorités, quitte à rendre impossible le fonctionnement normal du ministère68. Exit la justice pour les gens du commun : les magistrats nationaux les plus compétents se sont retrouvés à travailler comme consultants internationaux…
Le comportement de la Cour constitutionnelle en RCA fournit une autre indication de l’arbitraire qui règne et de la faible indépendance des juges. Pourtant, la Constitution adoptée à la fin de la transition en décembre 2015 lors d’un référendum qui s’est tenu dans des circonstances difficiles laissait augurer une évolution plus heureuse. Ce fut une nouvelle déconvenue, comme l’ont prouvé la gestion des différends électoraux et les pressions exercées sur les juges – soit dans un cadre privé, soit à partir de 2021 sur la place publique lorsque certains d’entre eux, considérés comme trop réticents aux requêtes du pouvoir, furent menacés physiquement.
Le coup porté à la fin du mois d’octobre 2022 à la Cour constitutionnelle – coupable d’avoir
rappelé la primauté des accords internationaux et disqualifié l’anglais comme langue nationale69, puis d’avoir refusé une réforme constitutionnelle qui aurait autorisé le président Touadéra à briguer un troisième mandat – n’a été que le dernier avatar, à ce jour, de la réduction de la loi à la volonté du prince. La présidente de la Cour, coupable d’avoir conduit l’adoption de deux décisions contraires à la politique du chef de l’Etat (l’une sur l’adoption d’une cryptomonnaie et l’autre sur un changement constitutionnel) a été mise à pied après la décision du pouvoir exécutif de la mettre à la retraite à l’université, alors qu’elle avait été choisie en 2017 par ses collègues de la faculté de droit pour y siéger. Que ces mêmes collègues aient acté ce diktat présidentiel en dit long sur l’enseignement du droit à l’université de Bangui. Qu’elle-même, après avoir redit le droit dans une lettre adressée au chef de l’Etat, ait cédé à son injonction en dit également beaucoup sur le fonctionnement des élites administratives centrafricaines70.
Certains observateurs locaux, peut-être peu charitables, ont alors rappelé que le comportement de la présidente n’avait pas été forcément exemplaire au moment des contentieux électoraux en 2021, car elle avait abondé dans le sens de la majorité présidentielle qui s’employait à fragiliser juridiquement les principaux chefs de l’opposition civile, notamment Martin Ziguélé, Karim Meckassoua et Anicet-Georges Dologuélé, en dépit de l’immunité qu’aurait dû leur procurer leur statut de parlementaire. Selon eux, cette résolution de la controverse aurait aussi pu se solder à terme par une nomination au gouvernement, si le président Touadéra avait eu besoin d’élargir ce dernier pour satisfaire les donateurs71. Pour ces observateurs à Bangui, l’ex-présidente de la Cour constitutionnelle a surtout réagi aux insultes dont l’avaient couverte des associations affiliées à la majorité présidentielle en montrant qu’elle pouvait être indépendante.
Reste que ce face-à-face s’est une fois de plus terminé par la victoire du pouvoir exécutif sur le pouvoir judicaire et que la Cour constitutionnelle privée d’un brillant esprit est désormais, comme elle l’a été sous François Bozizé, à la disposition de la présidence de la République.
Quant à la CPS, objet de toutes les attentions de la communauté internationale et d’organisations de défense des droits de l’homme, dont l’irénisme laisse coi, elle a posé des questions importantes et offert peu de réponses malgré ses quatre années d’existence, ce qu’on ne peut justifier simplement par la vacance liée à l’absence de recrutement de personnel72. Organe hybride, elle a été créée à Bangui le 22 octobre 2018 pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois, et est soutenue par la Minusca et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud)73.
Son mandat est de juger les criminels les plus importants, au motif que les tribunaux ordinaires ne peuvent le faire et que la CPI s’attache aux principaux responsables du drame sanglant qui s’est joué en RCA. Des responsables qui étrangement ont d’emblée été identifiés aux seuls dirigeants de groupes armés, sans que, à quelques très rares exceptions près, une attention soit prêtée à ceux qui ont retrouvé une place dans l’appareil d’Etat ou à la direction du pays après le drame.
Des arguments de trois ordres au moins témoignent de la faiblesse systémique d’une telle
institution, pourtant acclamée par les Nations unies et les donateurs, qui célèbrent un principe (fort honorable) mais ne se préoccupent pas d’une réalité plus compliquée.
D’abord, la création d’un tel tribunal et son fonctionnement représentent un coût sans
commune mesure avec le système judiciaire normal : pour pouvoir juger une vingtaine de cas qualifiés évidemment d’emblématiques (sans que ne soit jamais démontré qu’ils le soient pour la population), on sacrifie budgétairement un meilleur fonctionnement de la justice au quotidien dans un pays où l’institution judiciaire a toujours été dépourvue de moyens. En 2017, en sus du financement intégral de cet organisme, la communauté internationale a également dû batailler bec et ongles pour conserver les personnels centrafricains qu’elle avait choisis au terme d’une sélection organisée en toute transparence. En effet, le ministre de la Justice, peu satisfait du concours qui avait été organisé, avait substitué à la liste des candidats retenus une autre liste essentiellement composée de Mbaka-Mandja (le groupe ethnique du président), ce qui avait le double avantage de nourrir les soutiens du président et d’être informé par le menu des activités
des forces de police censées appliquer les mandats d’arrêt et surveiller la détention des personnes inculpées. De plus, comme le notent les rapports d’ONG74, le gouvernement avait fait preuve d’une hâte toute sénatoriale dans la mise en place de cette institution : la loi avait été votée en juin 2015, la Cour avait été installée en octobre 2018 et le premier procès a débuté en 2022.
Le deuxième argument est que les victimes, censées être au centre de tout ce système,
veulent certes la justice mais exigent également des réparations qui sont d’ordre symbolique et matériel. Les thuriféraires du cas sud-africain, élevé au rang de paradigme par des fonctionnaires internationaux peu rigoureux, oublient trop souvent de rappeler que l’enthousiasme vis-à-vis de la commission vérité et réconciliation sud-africaine a été sérieusement entamé par l’amnistie octroyée à tous ceux qui reconnaissaient leurs crimes et par l’absence de véritables réparations pour les pertes subies. En Centrafrique, derrière les déclarations d’usage, il n’y a aucun budget ni aucune politique pour répondre aux interrogations des victimes, simplement quelques rapports d’experts et des vœux pieux que l’on mentionne comme s’ils pouvaient miraculeusement se transformer en politique publique.
Le troisième argument est que la focalisation du discours international sur cette CPS a permis d’euphémiser les dérèglements au quotidien. Ainsi, les communiqués célébrant la condamnation de trois chefs de guerre en octobre 2022 comme une affirmation de la lutte contre l’impunité ont été publiés au moment même où une organisation en cour à la présidence de la République menaçait physiquement des opposants politiques et leurs progénitures.
Cette célébration de fonds bien dépensés ferait presque oublier l’incident qui est intervenu
lorsque la CPS a osé faire arrêter et incarcérer un ministre, Hassan Bouba, le 19 novembre 2021. Issu de la rébellion mais très proche du président Touadéra, celui-ci est un rouage important de la présence russe dans certaines zones du pays et a fomenté très activement des divisions dans le mouvement armé dont il est issu. Il a été libéré de sa détention préventive par des soldats de la garde présidentielle accompagnés d’éléments du Groupe Wagner. Il a non seulement réintégré ses fonctions ministérielles, mais le président Touadéra l’a décoré de l’ordre national du Mérite, la plus haute distinction centrafricaine, trois jours après cette libération spécieuse. Le ministre de la Justice a quant à lui tancé les juges de la CPS, coupables d’avoir agi sans en informer le ministère (une disposition évidemment indue !), tout en rappelant que les forces de l’ordre devaient obéir aux réquisitions de ce tribunal. Toujours ministre, Hassan Bouba circule aujourd’hui librement à
Bangui et dans l’arrière-pays, sans que ni la Minusca (dont c’est pourtant le mandat) ni les Forces de sécurité intérieure n’essaient de l’arrêter pour le remettre aux juges de la CPS.
Il est certes rassurant de voir des chefs miliciens se faire condamner alors que des proches
du président bénéficient d’une impunité totale et ne sont même pas poursuivis par le procureur de la République… Cette sélectivité crédibilise l’appréciation de certains : le soutien à la justice transitionnelle signifie un abandon de la justice nationale. De plus, l’absence de transparence de la CPS reste problématique, notamment en ce qui concerne les détentions provisoires et la sélection des cas à traiter, puisque c’est fondamentalement le gouvernement ou la Minusca qui procède (ou pas) aux arrestations.
Quant à la CPI, elle doit poursuivre les plus hauts responsables des crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Sa précédente intervention en RCA avait suscité une grande amertume. Le procès qu’elle a instruit contre le Congolais Jean-Pierre Bemba au terme d’une longue procédure – il a été arrêté en 2008 pour des faits qui s’étaient déroulés en 2002 et 2003 – s’est achevé avec son acquittement en juin 2018, décision qualifiée d’affront aux milliers de victimes. Elle a été saisie par le gouvernement centrafricain en mai 2014, et quatre prévenus ont été arrêtés depuis décembre 2018, mais on peine à comprendre les choix et la procédure suivis car l’un d’entre eux n’est qu’un petit chef sans envergure de la Séléka et les dossiers d’accusation sont mal préparés, laissant augurer la libération d’au moins un des accusés en détention provisoire. On peut donc légitimement avoir le sentiment que la CPI s’agite pour montrer qu’elle existe afin de couper court à un scepticisme grandissant au niveau international75.
Cette ambivalence éthique se retrouve, à un autre niveau, dans les comportements d’organisations de médiation dans les conflits, si l’on compare certains de leurs discours sur la Centrafrique avec leurs manières de procéder. Pendant les années de crise ouverte, le Conseil de sécurité des Nations unies n’a pas hésité à célébrer dans ses résolutions un accord de paix signé entre différents mouvements armés grâce à Sant’Egidio. Des responsables internationaux ont salué à d’autres occasions le travail réalisé par le Centre pour le dialogue humanitaire de Genève, comme si ces activités représentaient des acquis significatifs dans une paix qui se construisait.
Les deux organisations citées sont tout à fait honorables, et la critique ne porte que sur leur manière de combler le vide. Que sont les résultats obtenus par ces médiations et facilitations richement financées par l’Union européenne ou les Nations unies selon les cas ? Ce sont des déclarations aussi généreuses qu’irréalistes, signées par des individus lors de réunions souvent tenues hors sol, par exemple à Rome pour l’organisation italienne ou dans les locaux luxueux du seul grand hôtel de la capitale centrafricaine pour l’organisation suisse. Comme ont fini par le leur faire remarquer des dirigeants politiques centrafricains, une signature individuelle au bas d’un document transpirant de bonnes valeurs sans engagement ferme et sans sanctions pour les contrevenants, c’est peu cher payé pour une longue semaine de séjour en Italie et de substantiels perdiem. Comment se contenter de belles déclarations d’intention que personne n’entend mettre en œuvre ? Celles-ci peuvent avoir un sens dans une dynamique de négociation, mais il n’y a jamais rien eu de tel dans les années récentes en RCA. On pourrait reprendre tous les accords qui ont mené à une pacification depuis 2013 pour souligner la vanité des processus qu’ils étaient censés inaugurer.
Que ces organisations célèbrent de tels accords comme des pas décisifs fait réfléchir sur la
constitution d’un nouveau secteur du monde non gouvernemental, celui de la privatisation de la négociation – une pratique que Sant’Egidio avait pourtant refusée au début des années 1990 – et de constitution de véritables carrières dans ce secteur. Que ces accords se réduisent à des morceaux de papier reflète d’abord le vide politique d’élites centrafricaines qui comprennent les avantages qu’il est possible de retirer d’un moment de ni guerre ni paix, mais cela illustre aussi le cynisme de la communauté internationale qui se justifie par le financement de ces activités sans vouloir s’impliquer réellement. On est à la fois dans une démarche purement technique (on finance des billets d’avion, des perdiem et des consultants) et apolitique (du moment qu’il y a un accord, il est bon à prendre et s’il n’est pas respecté, c’est parce que les signataires sont des menteurs).
On doit s’inquiéter de ce que ces organisations acceptent une vision aussi déresponsabilisante de la pacification. Quelle est leur motivation ? Les généreux financements, la publicité que fournit la signature collective d’un accord dénué de conséquences, la simple nécessité de marquer sa place sur un véritable marché ? Il faut y voir plus encore l’incapacité croissante des diplomates à faire le travail qui devrait leur incomber : la privatisation de ce travail politique témoigne de l’obsolescence d’une certaine conception du métier de diplomate, un débat qu’on aurait voulu voir mener avec une plus grande profondeur en France au moment d’une énième réforme au Quai d’Orsay.
A suivre….!!!!
Centrafrique : la fabrique d’un autoritarisme
Les Etudes du CERI – n° 268-269 – Roland Marchal – octobre 2023