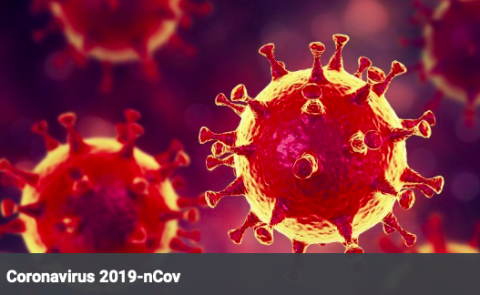CENTRAFRIQUE. La Cour constitutionnelle a tué la Constitution. Réplique à la “décision BENDOUNGA” du 4.04.2019
Mesdames et Messieurs de la Cour constitutionnelle de la République Centrafricaine, Qu’il vous plaise de souffrir d’entendre que par la décision que vous avez rendue ce 4 avril 2019 sur le recours de Monsieur BENDOUNGA, vous avez gravement méconnu votre office (votre rôle), manqué à votre mission et, partant, vous avez cautionné des violations manifestes et exceptionnellement graves de la Loi fondamentale des Centrafricains. Comme je vais le montrer à présent :
Vu la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016,
Attendu que, siégeant en Cour constitutionnelle et statuant sur le recours de Monsieur BENDOUNGA, citoyen et homme politique Centrafricain, tendant à ce que soit déclaré contraire à la Constitution l’accord du 6 février 2019, signé entre le Gouvernement de la République Centrafricaine et les groupes armés, vous avez énoncé ce qui suit :
« Considérant que l’accord du 6 février 2019 signé entre le Gouvernement de la République Centrafricaine et les groupes armés est un accord politique pour la paix et la réconciliation en République Centrafricaine. La Cour a une compétence d’attribution, ce qui signifie qu’elle ne se prononce que si la ou les questions posées relèvent de sa compétence ; Qu’en application des dispositions sus-citées, l’accord politique du 6 février et ses annexes ne font pas partie des actes soumis au contrôle de constitutionnalité » ;
Attendu que vous avez jugé en conséquence « qu’il y a lieu de rejeter la demande du requérant », Monsieur BENDOUNGA ;
Mais,
Considérant, premièrement, que la Constitution est l’acte juridique suprême de l’Etat ; que celle du 30 mars 2016 occupe cette position suprême dans l’ordonnancement juridique de l’Etat Centrafricain ;
Que, s’agissant d’un ordre démocratique, cette suprématie traduit le principe selon lequel la volonté du peuple centrafricain souverain s’impose absolument à toute autre volonté dans l’Etat ;
Considérant, deuxièmement, que si le contrôle de constitutionnalité des actes ne concerne que les actes juridiques, la qualité d’acte juridique ne saurait dépendre de la seule qualification retenue par les auteurs dudit acte ;
Que, pour savoir si l’on est en face d’un acte juridique, il faut et il suffit de constater qu’il s’agit d’une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ;
Que, expression de la volonté des négociateurs de Khartoum, à savoir le Gouvernement de la République Centrafricaine et les groupes armés qui occupent une partie substantielle de cet Etat, l’accord du 6 février 2019 est présenté par les parties elles-mêmes comme comportant des clauses obligatoires à l’égard non seulement d’elles-mêmes, mais aussi de tout sujet de droit en République Centrafricaine ;
Que, tant les crises survenues à l’occasion de la mise en œuvre dudit accord que les pourparlers qui s’en sont suivis à Addis-Abéba sous l’égide de l’Union africaine, ainsi que les décisions prises par le Chef de l’Etat pour faire suite aux conclusions de ces pourparlers confirment que l’accord du 6 février est bel et bien doté d’effets de droit, en particulier d’un effet contraignant ;
Que, en pratique cet effet se constate à travers divers actes règlementaires pris par le Chef de l’Etat en tant qu’actes d’application de l’accord, et dont le caractère juridique ne saurait être discuté ;
Que, en conséquence, l’accord du 6 février, en dépit de la qualification « d‘accord politique » retenue par les parties, est indiscutablement un acte juridique ;
Considérant, troisièmement, que il en va de même lorsqu’il s’agit de vérifier que tel acte relève ou ne relève pas de l’une des catégories d’actes prévues par la Constitution, telles que, par exemple, la loi organique, la loi ordinaire ou le décret ;
Que le seul fait que les auteurs d’un acte décident de le nommer autrement, par exemple « accord », « compromis », « feuille de route », ne suffit pas à le placer hors de l’une des catégories constitutionnelles ;
Que, en effet, les actes énumérés par la Constitution sont prévus pour permettre aux organes de l’Etat d’agir dans des domaines déterminés, qui sont exclusifs et non interchangeables ;
Que, ainsi, il existe en vertu de la Constitution un domaine de la loi (article 80), acte exclusif du pouvoir législatif, et un domaine du règlement (article 81), acte exclusif du pouvoir exécutif ;
Que, laisser à la discrétion des acteurs la dénomination des actes pris dans ces domaines reviendrait à vider la Constitution elle-même de toute substance, en laissant de surcroît à des personnes ou à des entités non habilitées par le peuple l’exercice de la souveraineté ;
Considérant, quatrièmement, que la Constitution est un acte d’organisation de l’Etat ;
Que, à cette fin, elle crée des organes et leur attribue des compétences, notamment la compétence pour édicter des actes juridiques ;
Que, ce faisant, la Constitution procède à la délégation de l’exercice de la souveraineté qui appartient au peuple, et à lui seul ;
Que, exerçant ainsi une puissance déléguée, les titulaires de ces compétences que sont notamment le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée Nationale, ne peuvent en déléguer l’exercice à d’autres organes constitutionnels ou, a fortiori, à des organes non prévus par la Constitution ;
Que pareille subdélégation constitue une violation de la Constitution dans le premier cas, et une violation grave de celle-ci dans le second cas ;
Considérant, cinquièmement, que, après avoir institué la Cour constitutionnelle, la Constitution fixe sa compétence ainsi que les cas dans lesquels cette compétence est et doit être exercée ;
Qu’il ressort de la Constitution que la compétence de la Cour constitutionnelle est, indiscutablement, une compétence d’attribution, c’est-à-dire une compétence qui ne trouve à s’exercer que dans les cas prévus par la Constitution ;
Considérant cependant, sixièmement, que la Cour constitutionnelle exerce, en vertu de la Constitution, notamment deux sortes d’attributions (article 95), qui font d’elle le juge de la constitutionnalité des lois et des décrets, d’une part, et le juge des compétences attribuées aux institutions de l’Etat, d’autre part ;
Que, en conséquence, il lui appartient, en premier lieu, non seulement de s’assurer que chaque institution n’empiète pas sur les compétences des autres institutions, mais aussi que chaque institution exerce la plénitude de la compétence à lui attribuée par la Constitution, sans en abandonner l’exercice à des entités non prévues par la Constitution ; qu’il lui appartient aussi, en deuxième lieu, de veiller à ce qu’aucun acte pris dans les domaines réservés par le Constituant au Pouvoir législatif et au Pouvoir exécutif n’échappe à l’obligation de respecter la Constitution ;
Considérant, septièmement et en conséquence de tout ce qui précède que, en jugeant que l’acte dont elle a été saisie ne fait pas partie des actes soumis au contrôle de constitutionnalité, la Cour a cautionné l’exercice de la souveraineté par des entités non habilitées par la Constitution et a privé la Loi fondamentale de tout effet à l’égard d’actes juridiques qui ont vocation à s’appliquer sur le territoire de la République Centrafricaine.
CONCLUSION :
Article unique : En statuant comme elle l’a fait, la Cour constitutionnelle de la République Centrafricaine a gravement porté atteinte tant à l’autorité qu’à l’existence de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016.
Jean-François AKANDJI-KOMBÉ