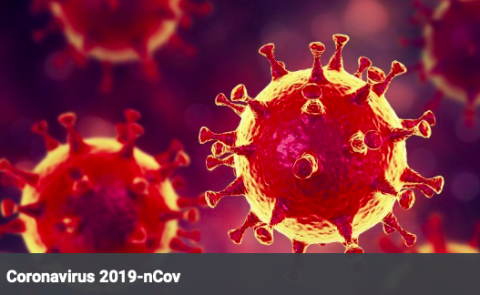Un nouveau massacre a eu lieu en République centrafricaine au lendemain d’un accord de paix avec les milices armées. Et en dépit de la présence de quelque 10 000 Casques bleus de la Minusca de plus en plus contestés.
Qui sauvera la République centrafricaine de ses démons ? Cette semaine, de nouvelles explosions de violences sont venues contredire une énième tentative pour mettre un terme au conflit sanglant qui endeuille depuis quatre ans ce pays enclavé au cœur de l’Afrique. Lundi, pourtant, la communauté Sant’Egidio, plusieurs fois impliquée par le passé dans des médiations de pacification, annonçait fièrement à Rome la signature d’un accord de paix entre 13 groupes rebelles et le gouvernement du pays. Au premier rang des gestes concédés par les parties présentes : la mise en place d’un cessez-le-feu avec effet immédiat. Mais dès mardi matin, Bria, une ville du centre du pays, était le théâtre d’affrontements sanglants qui feront 110 morts.
Les motivations de ce carnage ne sont pas très claires, d’autant que les belligérants appartiendraient eux-mêmes à des sous-groupes de factions adverses dans le jeu compliqué des alliances et contre-alliances qui déchirent ce pays plus grand que la France. Une seule certitude : les civils, et les communautés que ces bandes rivales sont censées défendre et représenter, sont les principales victimes de chaque massacre. A Bria, avant même la dernière attaque, 40 000 personnes vivaient déjà dans des camps de déplacés suite aux affrontements précédents qui se sont déroulés en novembre, puis en mars. Ils opposaient alors des factions rivales au sein de l’ex-Seleka, coalition hétéroclite à dominante musulmane qui avait pris le pouvoir en mars 2013 à Bangui, la capitale. Avant d’en être chassée début 2014. Depuis, l’ex-Seleka s’est retranchée dans l’immense arrière-pays, se divisant en une myriade de groupes qui règnent sur de petits territoires et se combattent parfois, quand ils n’affrontent pas les milices d’autodéfense chrétiennes, les «antibalaka». Ces dernières sont apparues fin 2013, au départ par réaction aux exactions commises par la Seleka lorsque celle-ci détenait encore le pouvoir. Depuis, chaque camp s’est rendu coupable d’un nombre inouï d’atrocités. Sans qu’on puisse pour autant résumer cette crise sans fin à une simple guerre de religions, dans un pays où les musulmans boivent de l’alcool et les chrétiens sont parfois polygames. Ni l’intervention de la force française Sangaris, qui a plié bagage fin 2016 après trois ans de présence dans le pays, ni la mise en place d’une force de l’ONU, la Minusca (dotée de 10 000 Casques bleus), n’ont permis jusqu’à présent d’enrayer l’expansion du chaos dans ce pays regorgeant de richesses minières mais dépourvu de routes et d’infrastructures, et qui détient désormais le triste record de se situer à la dernière place de l’indice de développement humain (IDH).
Reste qu’après bien des tentatives de conciliations, et malgré la mise en place d’un gouvernement et d’un Parlement élus il y a un an, la recrudescence des violences ces dernières semaines inquiète la communauté internationale. Le 13 juin, le Conseil de sécurité de l’ONU s’en alarmait officiellement en évoquant la nécessité de «reconfigurer» la Minusca pour la rendre plus efficace. Un euphémisme. «La Minusca n’a plus aucune crédibilité aux yeux de la population», souligne ainsi Roland Marchal du Centre de recherche internationale de Sciences-Po et spécialiste de la République centrafricaine. «Il n’y a aucune stratégie militaire car il n’y a aucune stratégie politique», explique le chercheur particulièrement scandalisé par les événements qui se sont déroulés il y a un mois à Bangassou, dans le sud-est du pays.
Inaction
Le 13 mai, des milices antibalaka attaquent cette ville située dans le sud-est et jusqu’à présent épargnée par les tensions. L’assaut est préparé avec une logistique inédite : armés de mortiers et de lance-grenades, plus de 500 hommes attaquent d’abord la base de la Minusca, puis font sauter le pont qui la relie à la ville avant de cibler le quartier musulman. «Les Casques bleus marocains ont appelé la population musulmane à se regrouper dans la mosquée. Mais lorsqu’ils ont été eux-mêmes ciblés par des snipers, ils sont partis», raconte Roland Marchal. Abandonnés par les Casques bleus, les musulmans ainsi regroupés devenaient une cible facile. L’évêque de Bangassou, Juan José Aguirre Munoz, un Espagnol installé dans le pays depuis prés de vingt ans, racontera plus tard à l’AFP comment il a vu l’imam sortir de la mosquée, mortellement blessé. Mais aussi comment les antibalaka l’ont empêché de prendre le corps du défunt. Investissant toute la ville, ces miliciens traqueront les musulmans jusqu’à l’hôpital où deux femmes seront arrachées de leurs lits : l’une tuée sur le coup, l’autre enterrée vivante, selon différents témoignages. Au total, on dénombrera plus de 100 morts.
Un mois plus tard, Bangassou reste sous l’emprise totale des antibalaka. Sans que les autorités à Bangui ne protestent. Sans que la Minusca ne tente de reprendre le contrôle de la ville. «C’est inadmissible de ne pas avoir empêché ce massacre. La Minusca savait qu’il aurait lieu et elle a abandonné les musulmans alors qu’il y a 150 Casques bleus marocains sur place», fulmine Roland Marchal. La conquête de Bangassou par des antibalaka aussi déterminés que bien organisés ne manque pas d’inquiéter de nombreux observateurs qui redoutent une «nationalisation» d’un mouvement qui affichait jusqu’à présent un enracinement et des revendications locales. Certains n’hésitent pas à accuser les autorités de la ville, le maire et le sous-préfet ainsi que deux députés, d’être complices des assaillants. Quant à l’inaction de la Minusca, elle tient peut-être aussi au traumatisme ressenti après une attaque qui s’était déroulée cinq jours avant l’assaut de la ville : le 8 mai un convoi de Casques bleus est attaqué à 20 km de Bangassou. Un Marocain trouve la mort, un autre est fait prisonnier en compagnie de quatre Casques bleus cambodgiens. Ils seront tous «sauvagement assassinés» selon les termes d’un porte-parole de l’ONU. «Pour les Casques bleus présents à Bangassou, ce fut vécu comme un avertissement», constate une source au sein de la Minusca, contactée à Bangui. Laquelle reconnaît aussi le problème de l’«incompétence» de certains bataillons.
«Vitrine»
Certes, tout le monde s’accorde sur l’efficacité de la force de réaction rapide constituée par un contingent portugais arrivé début 2017. Il sera d’ailleurs appelé en renfort à Bangassou mais retardé par… un autre massacre sur la route, à Alindao. Mais d’autres bataillons se montrent nettement moins à la hauteur de la tâche : «Les Marocains sont très limites. Ils refusent de combattre», souligne encore notre source à Bangui. Et que penser du bataillon envoyé par le Congo-Brazzaville ? Suite à des accusations de viols, 120 Casques bleus congolais avaient déjà été renvoyés chez eux l’an dernier. Ces jours-ci, leurs 629 camarades encore présents à Berbérati, la troisième ville de République centrafricaine seront à leur tour rapatriés après avoir été accusés de viols, de vol de carburant et de «manque de discipline». En février, la Minusca se targuait pourtant de pouvoir déclarer Bambari (au nord-ouest de Bangui) «ville sans armes». Le 19 mai, le président Faustin-Archange Touadéra se rendait dans la ville en compagnie de la directrice générale de la Banque mondiale pour signer une aide de 45 millions de dollars (40,3 millions d’euros), dont une grande partie en faveur des déplacés. «Bambari, c’est un peu Disneyland : la belle vitrine d’un pays très fragile», note Roland Marchal. « Même les opérations de démobilisation et de désarmements censées être mises en place dans le pays traînent et n’en sont qu’à la phase d’un projet pilote», confirme notre source à Bangui, qui a surtout retenu de l’accord signé lundi à Rome «l’incroyable catalogue d’avantages offerts immédiatement aux groupes armés alors qu’il n’y a aucune mesure coercitive prévue sur le non-respect de leurs propres obligations ni aucun calendrier contraignant». En réalité, l’accord signé à Rome ne semble guère avoir suscité d’espoirs dans le pays. «Personne n’y croit», résume un journaliste centrafricain contacté à Bangui. La République centrafricaine a certes bénéficié de l’aide de la France, à travers une opération militaire lancée au départ pour répondre à la crainte d’un «génocide» qui n’a jamais existé, comme le confirmera un rapport d’enquête de l’ONU en 2015.
Elle est depuis «protégée» par des Casques bleus dont même le Conseil de sécurité reconnaît désormais la nécessité de «reconfigurer l’action». Mais elle continue de vivre au rythme des massacres toujours impunis de chefs de guerre et miliciens qui s’allient et se combattent au gré des circonstances et des enjeux locaux. L’argent ne manque pas, «les élites et les fonctionnaires à Bangui ont même une forte capacité à l’absorber», ironise une source sur place qui fustige «les surfacturations auxquelles donne droit le moindre séminaire organisé en faveur de la paix». La solution ? «Un peu plus de détermination politique et de fermeté ne ferait pas de mal», soupire le même interlocuteur, désabusé : «Ici, on finit par s’habituer au pire».
Source : Libération